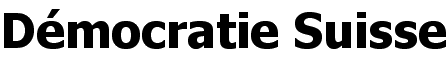Ethique et Institution - Livres et liens
Pathologie de la démocratie. Essai sur la perversion d'une idée. Christian Saves Edit. IMAGO
 La démocratie a eu raison de ses ennemis jurés, les systèmes totalitaires. Seul type de régime dorénavant acceptable, modèle indépassable, elle n'en est pas pour autant exempte de tout reproche. Cependant, le péril qui la menace n'est plus de nature extérieure ; il aurait plutôt des causes internes.
La démocratie a eu raison de ses ennemis jurés, les systèmes totalitaires. Seul type de régime dorénavant acceptable, modèle indépassable, elle n'en est pas pour autant exempte de tout reproche. Cependant, le péril qui la menace n'est plus de nature extérieure ; il aurait plutôt des causes internes.
Puisant ses exemples dans la vie politique des dernières décennies, Christian Savès s'interroge sur les ambiguïtés et les insuffisances de notre démocratie. Il énumère et analyse avec sagacité les affections qui l'anémient : séparation fictive des pouvoirs, conflit insoluble de la liberté et de l'égalité, défaillances du parlementarisme et sectarisme des partis, assujettissement choquant du citoyen à l'administration, du droit à la politique, complaisance obstinée des « clercs » pour les idéologies, corruption généralisée trahissant une crise magistrale de l'esprit civique et un recul sans précédent de l'éthique.
Loin des querelles partisanes, cet ouvrage met en évidence le nouveau défi lancé à la démocratie : reconnaître ses faiblesses pour mieux les surmonter, éviter ainsi la décomposition d'un idéal cher jadis à Socrate et qui, enrichi par l'Histoire, constitue la part la plus précieuse de notre héritage politique.
Qu'est-ce que la politique? Julien Freund. Edit. Sirey. Poche
 Sociologue français, disciple de Max Weber, Julien Freund est certainement l’un des penseurs les plus intéressants parmi ceux classés dans la droite française de la seconde moitié du XX° siècle.
Sociologue français, disciple de Max Weber, Julien Freund est certainement l’un des penseurs les plus intéressants parmi ceux classés dans la droite française de la seconde moitié du XX° siècle.
Voici une rapide note de lecture d’un de ses textes centraux : « Qu’est-ce que la politique ? » En contrepoint, par exemple, des travaux en cours sur Castoriadis.
La politique, nous dit Freund en introduction, passe aujourd’hui pour un pur objet de connaissance. C’est une erreur : elle est d’abord action, c'est-à-dire relation de moyen à fin. Relation qu’on peut envisager de trois points de vue :
- D’abord le point de vue moral, les catégories définissant la fin étant le bien et le mal ; point de vue erroné, non que la politique soit émancipée de la morale (il ne saurait en être question), mais parce qu’elle ressort d’un autre paradigme : la morale répond à une exigence intérieure selon les normes du devoir, alors que la politique traduit une nécessité de la vie sociale consistant à prendre en charge le destin d’une collectivité – ce qui impose, en particulier, de s’inscrire dans une éthique de responsabilité et non dans une éthique de conviction : peu importe en politique que je veuille faire le bien, l’important est que, au besoin à travers le mal, j’atteigne les objectifs politiques légitimes qui sont les miens.
- Ensuite le point de vue pratique, sous l’angle des procédés permettant de s’emparer du pouvoir, de la conserver et de l’exercer ; cette vision a fait l’objet de réflexions fort intéressantes (Machiavel), mais elle est trop limitative, car la responsabilité politique ne peut se restreindre à l’exercice d’une technique – il y a un moment où il faut décider, par delà la méthode, ce qu’est le but lui-même.
- Enfin le point de vue phénoménologique, celui de Julien Freund, qui admet que la politique est une activité autonome, au même titre que la science, l’art ou l’économie – activité autonome qui interagit constamment avec science, art et économie, mais possède sa finalité propre, et ses moyens propres.
Pour démontrer la pertinence de ce point de vue phénoménologique, il faut tout d’abord dégager une finalité propre à l’essence du politique – donc une finalité valable en tout lieu, en tout temps, et qui est spécifiquement politique. Peut-on dégager cette finalité ? A priori, non : le but même du politique ne cesse de varier, d’un temps à l’autre, d’un acteur à l’autre, d’un lieu à l’autre. En outre, l’action politique oblige en pratique à privilégier les buts immédiats, et dissimule le plus souvent les buts lointains, y compris à ceux qui les poursuivent inconsciemment. Le fond de la question réside dans le processus de décision – l’action politique par excellence, celle qui transforme la résolution en obligation de constance, donc de courage. Qu’est-ce qui fait qu’une décision authentiquement politique est prise ? Quel en est le mobile ?
Julien Freund répond : le but du politique se détermine en fonction du sens de la collectivité qu’il sert, car il consiste dans la volonté d’une unité politique de conserver son intégrité et son indépendance dans la concorde intérieure et la sécurité extérieure. Donc il existe un but qui définit l’essence du politique – conserver l’intégrité de l’unité politique – mais ce but téléologique dépend, dans son application pratique, du sens que l’unité politique se donne à elle-même, sens qui va déterminer les objectifs concrets en fonction du système de valeurs définissant le principe de finalité eschatologique.
Ce but téléologique, la conservation de l’intégrité de l’unité politique, peut être défini comme le bien commun (Thomas d’Aquin), le salut public (Hobbes), l’intérêt commun (Rousseau), le bien de l’Etat (Hegel), le bien du pays (Tocqueville). Au-delà des nuances apportées par ces définitions, concrètement, il s’agit toujours :
- première sous-fonction, de préserver la sécurité extérieure (fonction prioritaire du politique), par la diplomatie et les alliances si possible, à défaut par la guerre,
- et deuxième sous-fonction, de garantir la concorde intérieure, créatrice de prospérité, si possible par le maintien de l’harmonie entre les groupes internes, à défaut par la contrainte. On remarquera que la construction du sens commun sous-tend nécessairement cette deuxième sous-fonction du politique, et que ce sens est lui-même construit par la nécessité de garantir la cohésion de l’unité politique. Ainsi, le politique, qui repose sur la cohérence du système de référence, est lui-même producteur de ce système (d’où la phrase de Max Weber : « Ce n’est pas la paix et le bonheur que nous avons à procurer aux générations futures, mais la lutte éternelle pour la conservation et l’édification de notre caractère national » - le but du politique est, d’une certaine manière, la redéfinition permanente de son but).
Cette production du sens commun est d’autant plus indispensable à la définition du bien commun que le bien commun est résolument unitaire, c’est le bien de toute la communauté, alors que la communauté elle-même n’est jamais unitaire. Le politique est donc, sous cet angle, avant tout production d’un discours qui fondera la paix par l’amitié de la communauté avec elle-même, amitié qui sera fréquemment définie par la conscience de l’ennemi commun.
Sans ce discours fondateur du sens, la politique ne débouche sur rien, quelle que soit l’habileté déployée dans l’utilisation de ses moyens propres. Freund cite le cas de Tamerlan, qui sut conquérir la moitié de l’Asie, mais qui, faute d’avoir produit le sens capable d’assurer la cohésion de son empire, ne laissa finalement qu’une œuvre sans lendemain.
A l’inverse, dans de nombreux cas, la production du discours fondateur du sens est la seule finalité poursuivie par les acteurs eux-mêmes, c’est leur motivation réelle. En l’occurrence, le politique cesse de poursuivre sa finalité téléologique, la préservation de l’intégrité de l’unité politique. L’enchaînement des causes et des conséquences est, en politique, tellement difficile à anticiper que très souvent, les résultats d’une action ne sont pas du tout ceux qui étaient initialement visés, et on en arrive assez vite au point où l’action sert avant tout à reconstituer une logique – on agit pour corriger les dysfonctionnements induits par une action antérieure, et cette correction poursuit l’objectif secret de reconstituer une cohérence perdue, parce qu’en politique, imposer sa cohérence, c’est vaincre.
Cela est d’autant plus vrai qu’en politique, le seul moyen de démontrer sa compétence, c’est précisément de vaincre. Le politique n’a pas à affronter la question de la responsabilité morale, à peine celle de la culpabilité. En revanche, la défaite lui est interdite, et surtout sur le terrain du sens. Le politique qui ne parvient plus à formuler un système de fins cohérent disparaît en tant qu’acteur, il est le jouet des forces qui sont, elles, capables de formuler un tel système.
Sous cet angle, la politique poursuit une finalité eschatologique suprême, dissimulée derrière la définition d’un système de sens cohérent, garant de la robustesse du discours sur le bien commun : conserver la foi, c'est-à-dire la confiance en la cohérence de l’Etre, en la possibilité que cette cohérence s’incarne dans l’esprit d’un homme libéré de toute aliénation. Agir en politique, pour Julien Freund, c’est donc implicitement soit témoigner de sa foi monothéiste (unité des fins), soit témoigner de sa libération polythéiste à l’égard de la quête de la foi (capacité à assumer la concurrence des fins). C’est dans tous les cas un acte religieux par essence, même si ceux qui accomplissent cet acte n’ont souvent pas conscience de son caractère religieux.
Après s’être interrogé sur les finalités du politique, Freund décortique ses moyens.
Il affirme que la force est le principal de ces moyens, et que c’est parfaitement légitime (le politique doit agir pour vaincre). Et comme la ruse elle-même n’est jamais qu’une auxiliaire de la force, son équivalent dans le domaine de l’esprit, la force se trouve au final non seulement le moyen principal, mais encore souvent l’unique moyen du politique. Sans la force, il n’y aurait ni stabilité, ni paix durable possible, car c’est en engageant la force que les acteurs politiques témoignent de la réalité de leur conviction. Sans contrainte par la puissance publique, il n’y aurait pas de justice.
La force politique n’est en rien l’ennemie du droit juste : voilà le cœur du propos de Freund. Si la violence aveugle est toujours l’ennemie du droit naturel, la force politique, encadrée par la raison, quant à elle, n’est que le principe sous-jacent sous le droit. On croit voir une opposition entre force politique et droit positif : il n’y en a pas. Le droit n’est qu’un instrument auxiliaire de la force, au service du politique au même titre qu’elle.
Il est important, souligne Freund, de comprendre en quoi le droit avec la force est, lorsque le rapport de force le permet, préférable à la force sans le droit. C’est que par le droit, le politique entre au contact avec l’exigence de justice et de bien être, et d’une manière générale avec toutes les demandes humaines. Ainsi, le politique en s’appuyant sur le droit ne se donne pas seulement les moyens de ses finalités téléologiques immédiates (préserver la sécurité et garantir la concorde), il aboutit également dans cette construction du sens commun, réunifié, réconcilié avec lui-même, qui est la finalité eschatologique de la politique.
La conclusion de Freund est donc, on l’aura compris, orientée vers la réfutation d’un certain projet marxiste de la société sans classe, donc sans rapports de force et sans compromis à imposer à travers le jeu des forces contraires. Pour Freund, le politique est autonome ; vouloir le réduire à un simple miroir de l’infrastructure économique, prétendre qu’il participe de l’aliénation dès lors qu’il renonce à abolir les classes, c’est se tromper du tout au tout. Le politique est précisément, aux yeux de Julien Freund, ce qui permet de dépasser l’aliénation, dans la confrontation permanente à l’autre.
Et il conclut :
« De ce point de vue, rien ne semble plus arbitraire que la définition que G. Lukacs donne de la pensée bourgeoise : la mentalité qui considère l’histoire comme une tâche insoluble. Quelle ignorance nous autorise à penser que le prolétariat apportera la solution ? Il semble plus exact de dire avec Ranke que chaque époque et chaque génération sont également proches de Dieu – et nous aimerions ajouter : également proche de l’homme. »
Collé à partir de <http://www.scriptoblog.com/index.php?option=com_content&view=article&id=188:quest-ce-que-la-politique-julien-freund-&catid=52:philosophie&Itemid=55>
L'éthique expliquées à tout le monde. Roger-Pol Droit. Edit. Seuil Tu parles de jugements moraux, du bien et du mal, des valeurs, etc. L’éthique, finalement, c’est pareil que la morale ?
Tu parles de jugements moraux, du bien et du mal, des valeurs, etc. L’éthique, finalement, c’est pareil que la morale ?
Cette question a déjà soulevé de nombreux débats ! Le problème, c’est qu’il est aussi exact de répondre : « Oui, c’est la même chose » que : « Non, c’est différent. »
Comment sortir de là ?
Très simplement, car ce n’est pas au même étage, si je puis dire, que les deux termes sont semblables et qu’ils sont différents.
Commençons par l’étage où ils se confondent. On vient de le dire : les Grecs de l’Antiquité se servaient du terme « éthique » pour désigner ce qui concerne les comportements d’une collectivité ou d’un individu, ce qui est relatif aux mœurs, bonnes ou mauvaises, des êtres humains à un moment donné. Les Romains, à leur suite, ont fait la même chose dans leur propre langue, le latin. Pour traduire èthikè en latin, Cicéron a d’abord pris l’équivalent latin de èthos, c’est-à-dire mos, les mœurs, au pluriel mores. Pour exprimer « ce qui est relatif aux mœurs », il a inventé le terme moralia, c’est-à-dire « les données morales », construit sur le même modèle que èthikè.
Ainsi, « morale » dit en latin exactement la même chose que èthikè en grec. Ce sont deux mots parfaitement semblables, même s’ils sont forgés sur des racines différentes. « Morale » est bien la traduction, dans le latin classique, de ce que les Grecs nommaient « éthique ». A partir de ces fondements identiques, une série de domaines semblables se sont constitués : « éthique » et « morale » se préoccupent indistinctement des valeurs, et d’abord du bien et du mal, réfléchissent identiquement sur les fondements de ces distinctions, se demandent semblablement comment discerner, et comment appliquer, les règles fondamentales. Ces démarches se poursuivent en parallèle, dans une langue ou dans une autre.
Alors, d’où vient la différence ?
Il y a encore aujourd’hui des penseurs qui affirment qu’en fait il n’y a pas de vraie différence entre éthique et morale. Je crois, pour ma part, qu’il n’y a effectivement aucune coupure profonde et radicale entre les deux notions. Toutefois, une différenciation progressive s’est établie dans les usages des deux termes.
A l’époque moderne, on a souvent considéré que le terme « morale » pouvait être réservé au type de normes et de valeurs héritées du passé et de la tradition, ou bien de la religion. « Morale » s’est plus ou moins spécialisé dans le sens de « ce qui est transmis », comme un code de comportements et de jugements déjà constitué, plus ou moins figé. En ce sens, on accepte ou on rejette la morale de sa famille ou de son milieu, on suit les préceptes qui la caractérisent, ou bien on les transgresse. La morale semble constituer un ensemble fixe et achevé de normes et de règles.
Aujourd’hui, au contraire, le terme « éthique » s’emploie plutôt pour les domaines où les normes et règles de comportement sont à construire, à inventer, à forger au moyen d’une réflexion qui est généralement collective. Par exemple, l’avancement des techniques médicales crée à notre époque des situations totalement inconnues des générations précédentes. Il est devenu possible de pratiquer des fécondations in vitro, ou de faire en sorte qu’une femme, le temps de la grossesse, porte l’enfant d’une autre - ce qu'on appelle une « mère porteuse » - et le restitue après la naissance.
Face à ces situations inédites, on se demande s’il faut autoriser ou interdire ces pratiques, si elles sont bonnes ou mauvaises, dans quels cas, pour quelles personnes, à quelles conditions. Là, il faut élaborer des règles, les façonner, tenir compte de plusieurs points de vue, trouver éventuellement des compromis. Ce travail est celui de l’éthique, dans le vocabulaire contemporain.
En résumé, si l’on veut distinguer les deux termes, « morale » serait du côté des normes héritées, « éthique » du côté des normes en construction. « Morale » désignera principalement les valeurs existantes et transmises, « éthique » le travail d’élaboration ou d’ajustement rendu nécessaire par les mutations en cours. Source: www.rpdroit.com
Cosmologie et politique. Jan Marejko. Edit. L'Age d'Homme / Essais Pourquoi les régimes politiques modernes se disentils démocratiques alors que tout ou presque tout les sépare des démocraties antiques ?
Pourquoi les régimes politiques modernes se disentils démocratiques alors que tout ou presque tout les sépare des démocraties antiques ?
Comment les hommes modernes peuventils s'estimer libres d'un côté et, d'un autre côté, prisonniers de formidables technostructures ?
Pourquoi l'espace infini de la cosmologie moderne estil un espace carcéral? Quel rapport entre maladie mentale et principe d'inertie?
Par quel processus la cosmologie newtonienne estelle devenue le fondement de l'économie moderne ? •
Dans quelle mesure l'image du monde issue du cartésianisme atelle légitimé le totalitarisme ?
L'exploitation de la nature impliquetelle nécessairement l'exploitation de l'homme par l'homme?
Pourquoi le pouvoir n'acquier-t-il aujourd'hui sa légitimité que par l'organisation ou la protection des activités économiques ?
Le corps humain estil un microcosme ou un simple morceau d'espace?
Telles sont quelques unes des questions abordées dans Cosmologie et Politique.
Après avoir vécu à Paris, New York et Boston, Jan Marejko s'est installé à Genève où il est professeur de philosophie et journaliste.
Les Pathologies de la démocratie. Cynthia Fleury. Edit. Biblio essais
 Où en sommes-nous de la démocratie française ? Qu'avons-nous fait des valeurs et des principes prônés par la démocratie naissante de 1789 ? Dans quelle mesure sont-ils toujours opérants ? Pourquoi, et par quels processus, certains d'entre eux se sont-ils pervertis Quel prix payer pour que la démocratie reste le meilleur garant des principes qu'elle instaure ? Comment concevoir un destin commun à l'ère de l'individualisme collectif ? En un mot, comment conduire la démocratie à l'âge adulte ?Où en sommes-nous de la démocratie française ? Qu'avons-nous fait des valeurs et des principes prônés par la démocratie naissante de 1789 ? Dans quelle mesure sont-ils toujours opérants ? Pourquoi, et par quels processus, certains d'entre eux se sont-ils pervertis Quel prix payer pour que la démocratie reste le meilleur garant des principes qu'elle instaure ? Comment concevoir un destin commun à l'ère de l'individualisme collectif ? En un mot, comment conduire la démocratie à l'âge adulte ?
Où en sommes-nous de la démocratie française ? Qu'avons-nous fait des valeurs et des principes prônés par la démocratie naissante de 1789 ? Dans quelle mesure sont-ils toujours opérants ? Pourquoi, et par quels processus, certains d'entre eux se sont-ils pervertis Quel prix payer pour que la démocratie reste le meilleur garant des principes qu'elle instaure ? Comment concevoir un destin commun à l'ère de l'individualisme collectif ? En un mot, comment conduire la démocratie à l'âge adulte ?Où en sommes-nous de la démocratie française ? Qu'avons-nous fait des valeurs et des principes prônés par la démocratie naissante de 1789 ? Dans quelle mesure sont-ils toujours opérants ? Pourquoi, et par quels processus, certains d'entre eux se sont-ils pervertis Quel prix payer pour que la démocratie reste le meilleur garant des principes qu'elle instaure ? Comment concevoir un destin commun à l'ère de l'individualisme collectif ? En un mot, comment conduire la démocratie à l'âge adulte ?
Démocratie délibérative, démocratie débattante, démocratie participative Alban Bouvier
Alban Bouvier
La démocratie délibérative et la démocratie participative sont des idées extrêmement en vogue aujourd’hui, en France aussi bien qu’au Canada, aux Etats-Unis aussi bien qu’au Brésil. On passe souvent insensiblement de l’une à l’autre notions, la démocratie délibérative étant souvent perçue comme une sorte de variante contemporaine de la démocratie participative, mettant l’accent plus que les variantes plus anciennes, rousseauiste par exemple, sur l’exigence de débats argumentés entre les citoyens. Pourtant, entre les expériences de gestion du budget de la municipalité de Porto Alegre par les habitants de la ville («budget participatif
») et les débats des théoriciens du droit américains sur le sens à donner à laConstitution de 1787 (amendée et modifiée de nombreuses fois, mais toujours en vigueur) et sur le rôle qui doit être, en conséquence, celui de la Cour suprême, entre ces expériences mêmes et les procédures diverses de concertation ou de débat public désormais coutumières en France et au Canada, il y a plus qu’une marge. Surgit en conséquence l’idée que, sous une unité qui pourrait n’être que de façade, seraient en jeu des conceptions très sensiblement différentes de ce que veut dire «délibérer» et «participer» dans une démocratie.
suite
Source: Revue Européenne des sciences sociales.
Texte intégral en libre accès disponible depuis le 01 février 2010.
Quelques questions sur les fondements des droits humains Jean-Daniel Nordmann
Jean-Daniel Nordmann
1ère Partie : droits et désir de l’Homme
L’angoisse fait l’Homme
Ce n’est pas d’aujourd’hui que le coeur de l’Homme est inquiet. Si l’on souhaite définir avec précision, dans la chaîne qui mène, paraîtil, du singe à l’humain, le moment exact de l’apparition d’une conscience humaine, on devrait s’attacher à repérer l’apparition de l’angoisse, intimement liée à la conscience du temps. Cette expérience est évidemment impossible ; en formuler la possibilité dans l’imaginaire permet au moins une prise de conscience : dès que l’Homme paraît, naît avec lui la tension entre...
suite
 Présentation de l'éditeur
Présentation de l'éditeur Présentation de l'éditeur
Présentation de l'éditeurUne des originalités de ce sujet est de poser des questions qui ne sont jamais soulevées quand il s’agit d’atteintes traditionnelles aux biens et aux personnes. Où placet- on le curseur entre les déviances acceptables et celles qu’il faut réprouver pour assurer la stabilité d’une organisation sociale ? Suffit-il d’une norme pénale pour identifier un acte transgressif ? S’il y a bien eu des abus, leurs auteurs sont-ils vraiment mal intentionnés ? Ne sont-ils pas plutôt victimes d’organisations laxistes et de pratiques tolérées ? Quelle est enfin la sanction adéquate à ces débordements ? Ces enjeux sont autant intellectuels que politiques et éthiques.
Afin de pouvoir construire des positions réfléchies sur le sujet, la maîtrise des connaissances scientifiques existantes est un préalable indispensable. Tel est l’apport de cet ouvrage.
 Présentation de l'éditeur
Présentation de l'éditeurMythes antirépublicains, laïcité et communautarisme
(Qu'est-ce que le communautarisme ?)
par Catherine Kintzler
En ligne le 24 février 2011
Le personnage du républicain « laïcard franchouillard » est un grand classique du roman antirépublicain. Ce mythe n'a aucun fondement conceptuel, mais il s'incarne dans une caricature et donne naissance à des fantasmes dont les effets sont bien réels. Le franchouillard et le multiculturaliste se confortent l'un l'autre en construisant de toutes pièces leur objet fantasmatique commun que les uns révèrent et que les autres abhorrent : « les musulmans », comme s'il s'agissait d'un bloc identitaire unifié. Ce faisant, tous deux confondent le communautaire et le communautarisme. Il importe de rappeler que la laïcité, qui s'oppose au communautarisme politique, n'a rien contre les communautés d'association, car toute communauté n'est pas communautariste. Il faut donc se demander ce qu'on entend au juste par communautarisme.
Lire la suite sur le BLOG de Catherine Kintzler
Source: Mezetulle Blog-revue de Catherine Kintzler
Le néo populisme est arrivé, par Alexandre Dorna
L’historique des populismes nous a permis de saisir le va-et-vient de ses contradictions idéologiques et de ses postures antonymiques. Aussi bien que le rôle vital de ses figures charismatiques, toutes différentes et toutes bariolées. Et un discours obéissant à des règles à géométrie variable. Avec cependant un air de famille qui traverse toutes leurs histoires. Un positionnement idéologique chargé d’interpellation avec une volonté d’articulation des conflits, des classes et des paroles. A y réfléchir, sommes-nous devant une théorie politique implicite (sociologique et psychologique) dont les éléments éclatés nous parlent d’un paradigme perdu où « la » politique n’est pas séparée « du » politique, l’opinion de la connaissance, et l’homme de la cité.
Si le populisme confère une identité aux déçus, aux démunis, aux révoltés, alors nous avons certainement intérêt à retrouver ses traces et à prêter attention à ses paroles. Il y a là, peut-être, une zone inexplorée de la connaissance anthropo-psycho-politique, car le populisme est en quelque sorte un concentré d’affectivité retenue. Une richesse archéologique enterrée sous un amas de malentendus et de préconçus échafaudés tout au long de ses affrontements avec les élites gouvernantes en déperdition de sens. Une forme d’action qui nous rappelle le besoin de penser la politique politiquement. Pour y voir un peu plus clair, observons, avec les yeux grands ouverts, en suivant le conseil de B. Gracian, les divers passages des populistes qui, à la manière des comètes, traversent de temps en temps le firmament politique de nos sociétés modernes, laissant une traînée d’éléments divers qui parlent de l’origine de notre culture.
Premier élément : le populisme n'est pas un simple mouvement de masse, mais un processus de masse, sous le signe de la protestation et en réaction à l'attitude (jugée courageuse) et à l’appel au peuple lancé par un leader charismatique qui affronte le système politique en place et les élites au pouvoir
.
Deuxième élément : Le style charismatique du leader compte pour beaucoup, car la forme entraîne le fond. C’est le jeu de la séduction et du savoir-faire, de la finesse dans l’esquive, du contact direct et chaleureux avec autrui. Il a l’énergie contagieuse, la dimension anti-dépressive et l’enthousiasme charismatique, dont les gouvernants sont dépourvus.
Troisième élément : La parole du leader charismatique épouse la rhétorique, mais rarement la démagogie, et, si l’imposture guette le chef démagogue, la démesure accompagne le leadership populiste.
Quatrième élément : Le ciment du populisme n’est pas sociologique, mais psychologique, véritable socle sur lequel tous les autres composants (sociologiques, politiques et économiques) se mettent en place pour former un nouveau monde imaginaire. La caractéristique principale du populisme n’est pas l’effervescence sociale, mais son potentiel de contestation.
Cinquième élément : L’appel des leaders populistes s'adresse à tout le peuple, avec une farouche volonté de rupture, mais tout particulièrement à tous ceux qui subissent en silence l’impasse et la misère, afin de contribuer au retour de l’unité nationale. Il y a donc évocation des grands mythes fondateurs et vision d’un avenir à la hauteur des espoirs de la nation. Les gestes symboliques jouent ici un formidable rôle de reconnaissance.
Sixième élément : les populismes émergent toujours associés à une situation de crise sociétale profonde, touchant à la fois les valeurs et le système politique en place. Cette crise, faut-il la chercher en amont d’une politique opaque et d’une classe politique coupable de confiscation de la volonté populaire ? Ou en aval, avec la perte de repères, le manque de confiance dans l’avenir, le conformisme des citoyens, l’impression d'un épuisement culturel et idéologique, l’érosion de la cohésion sociale, l’immobilisme des institutions, la désintégration de l’âme collective, la disparition accélérée de la tradition. En somme, une perte de sens qui se traduit par l’abandon d’un projet d’avenir commun.
Septième élément : C’est l'alchimie de trois composantes psychologiques qui font du populisme une sorte de révolte spontanée : la déception, la frustration et l’attente.
Huitième élément : Le leader populiste se distingue d'autres types charismatiques (Dorna 1998) par la plasticité et l'habileté avec laquelle il façonne une communauté émotionnelle de suiveurs, organisés en cercles concentriques autour de sa propre personne. La magie se trouve dans le contact direct et le dialogue avec tous, les échanges ouverts, vivaces, directs et l’attitude de disponibilité permanente, sans affectation ni calcul apparent. En synthèse, ces éléments habitent toutes les expériences populistes.
D’où l’hypothèse d’une conception politique universelle et concrète qui permet d’envisager la recherche de ses mécanismes. Certes, il y a certaines situations plus riches que d’autres. Inutile d’insister sur tel ou tel point. Il n’existe pas une fabrique unique de populismes ni un moule standard de leaders. Chaque contexte et chaque culture produiront une forme distincte de populisme. Cela est valable aussi pour la présence et la formation plus ou moins flamboyante des leaders charismatiques. AD
Source: l'Observatoire de la démocratie
L'Humanisme- Défintion et références historiques
L'humanisme est un mouvement européen de la Renaissance et une philosophie qui place l'être humain et les valeurs humaines au centre de la pensée. Il englobe les XIVe, XVe et XVIe siècles. L'humanisme se caractérise par un retour aux textes antiques, et par la modification des modèles de vie, d'écriture, et de pensée.
Au sens moderne, l'humanisme désigne toute pensée qui met au premier plan de ses préoccupations le développement des qualités essentielles de l'être humain et qui dénonce ce qui l'asservit ou le dégrade.
L'an 1453 voit la chute de l'Empire byzantin, suite à la prise par l'Empire ottoman de sa capitale Constantinople. Une nouvelle ère commence alors, qui va voir naître la pensée humaniste.
Des hellénistes vont émigrer en Italie et profiter du mécénat des citoyens riches des républiques commerçantes de génoise et florentine, ainsi que du pape. Grâce à ces apports culturels, une nouvelle pensée et un nouvel art vont se développer : ils sortent du cadre rigide hérité des anciennes institutions qui avaient le monopole de la diffusion du savoir, et qui étaient très liées aux autorités ecclésiastiques : monastères, écoles urbaines, universités. Flavio Biondo, qui fut l'un des artisans de ce renouveau, appela l'ancienne période le Moyen Âge, par opposition au Rinascimento (Renaissance en italien).
Profitant de l'apparition de l'Imprimerie en Europe (1453) le mouvement se diffuse sur tout le continent aux XVe et XVIe siècles à travers ce qu'on appellera la République des Lettres. Les nouveaux penseurs qui forment celles-ci seront nommés les humanistes, et à partir de la seconde moitié du XIXe siècle leur mouvement sera appelé l'Humanisme.
Le terme est formé sur l'allemand Humanismus, venant lui-même du latin : au XVIe siècle, l'humaniste s'occupait d'humanités (studia humanitatis en latin) ou lettres antiques). Pour ces érudits de la Renaissance, le terme humanitas avait le même sens qu'à l'époque cicéronienne et représentait « la culture qui, parachevant les qualités naturelles de l'homme, le rend digne de ce nom ».
Le terme désigne donc un courant culturel, scientifique, philosophique et, par bien des aspects, politique qui propose un « modèle humain » défini comme synthèse des qualités intellectuelles, sociales, affectives, caractéristiques de la « nature humaine ». L'humanisme est un courant de pensée idéaliste et optimiste qui place l'Homme au centre du monde, et honore les valeurs humaines.
Pris au sens large moderne, le terme humanisme peut recouvrir différentes idéologies antagonistes postérieures aux humanistes de la Renaissance : philosophie des Lumières, libéralisme et marxisme notamment.
Le sens historique
C’est avec Pétrarque (1304-1374) que naît en Italie le mouvement humaniste de la Renaissance. Le poète commence par recueillir les inscriptions sur les vieilles pierres de Rome et poursuit dans les manuscrits sa quête des Anciens. Il retrouve ainsi des lettres de Cicéron, ressuscitant un écrivain statufié par les écoles. Il s’illustre également en détectant un faux document au profit de son souverain. Lorenzo Valla (1407-1457), lui aussi, va traquer la vérité historique, préconisant l’étude philologique des textes et le retour à la pureté classique. Parti d’Italie, le courant humaniste rayonne dans toute l’Europe cultivée.
Les humanistes du XVe siècle s’efforcent de revisiter la pensée des Anciens, dont l’authenticité leur échappe après les présentations et interprétations chrétiennes des deux siècles précédents (voir Moyen Âge).
De 920 à 1200, on redécouvrit un grand nombre d'auteurs antiques, pour n'en citer que quelques-uns : Virgile, Ovide, Horace, Cicéron… Cette période est maintenant considérée par les plus grands historiens comme une période de renaissance (Georges Duby, Bernard Quilliet). En revanche, les XIIIe et XIVe siècles furent beaucoup plus rigides.
Ils étudient les langues anciennes (grec, hébreu, latin classique, syriaque) et recherchent des manuscrits dans tout le monde méditerranéen.
On considère généralement que l'âge d'or de l'humanisme se situe au début du XVIe siècle avec les grandes figures d'Erasme, Thomas More ou Guillaume Budé. L'humanisme de la Renaissance prône l'« imitation des Anciens », c'est à dire un retour aux sources antiques païennes (grecques et romaines) mais aussi chrétiennes (retour aux enseignements purs des Évangiles).
Les caractéristiques de l'humanisme du XVIe siècle sont l'aspiration à la connaissance des possibilités humaines et la réflexion de l'homme sur lui-même; le refus de tout ce qui fait obstacle au développement de l'esprit ; le rejet de toute autorité arbitraire; la volonté d'une nouvelle organisation de la vie qui se manifestera sur le plan politique, social, esthétique et même religieux.
Les Humanistes sont d'abord des « philologues », passionnés pour les langues (latin, grec, hébreu) et les civilisations anciennes. Ils réfléchissent sur les textes, reprennent les mythes et les légendes en les chargeant de nouvelles significations, écrivent des œuvres littéraires et scientifiques, deviennent des éditeurs. Dans un sens étroit, l'Humanisme du XVIe siècle est un mouvement littéraire qui cherche à retrouver une image éternelle de l'homme et du bonheur par l'étude de l'Antiquité.
Les Humanistes s'opposent aux dogmes de l'Église. Leur pensée touche exclusivement les pratiques ecclésiastiques, et non pas la religion. Ils exigent : le retour aux textes de l'Évangile, la confiance dans la « parole sacrée du texte » et non dans son commentaire, la traduction des textes religieux en langues romanes pour les rapprocher du peuple. Toutes ces exigences sont liées à la volonté de réformer l'Église catholique pour assurer son retour à la pureté primitive du christianisme. Luther en Allemagne et Calvin en France créent le mouvement qui porte le nom de la Réforme. Née de l'Humanisme, la Réforme s'en sépare par l'affirmation d'une nouvelle doctrine dont la défense acharnée provoque la scission de l'Église en deux camps, catholique et protestant, et les amène aux guerres civiles sanglantes.
Cet humanisme donnera naissance au protestantisme et, avec quelque retard, aux réformes catholiques (concile de Trente). Cet humanisme connaîtra une évolution qui le mènera, en passant par une phase moderne au XVIIIe, à l'humanisme scientifique du XIXe siècle.
À la Renaissance, l'humanisme a donc consisté en une mise en avant des richesses culturelles contenues dans les littératures anciennes. Cette entreprise a comporté plusieurs aspects :
l'humanisme philologique fut un immense travail de restitution et de diffusion des textes anciens d'auteurs inconnus des copistes du Moyen Âge. Ce fut la tâche de Pétrarque, de Boccace, de Marsile Ficin, d'Érasme, de Budé, par exemple
l'humanisme pédagogique s'opposa à l'enseignement scolastique en imposant l'étude des lettres latines et grecques dans leurs textes authentiques. François Ier fonda le Collège de France, à l'instigation de Guillaume Budé, dans le but de faire prévaloir cette pédagogie fondée sur l'étude des « humanités » antiques ;
l'humanisme philosophique est fondé sur la connaissance de l'homme, l'accomplissement harmonieux de sa nature, sous le contrôle de sa Raison. Pour Rabelais, Érasme, Montaigne, la valeur des œuvres antiques tenait dans la philosophie morale qu'ils y trouvaient. Celle-ci leur apprenait que la mesure des désirs et des ambitions, le courage et la justice conduisaient à la vertu et au bonheur. Alors qu'il n'était pour d'autres que l'étude érudite de textes, l'humanisme fut pour eux une « conception sobre et équilibrée de la vie humaine » (Emile Bréhier). À la fin de l'Apologie de Raymond Sebond, Montaigne cite Sénèque : « Ô la vile chose et abjecte que l'homme, s'il ne s'élève au-dessus de l'humanité ! » et il commente : « Voilà un bon mot et un utile désir, mais pareillement absurde. Car de faire la poignée plus grande que le poing, la brassée plus grande que le bras, et d'espérer enjamber plus que l'étendue de nos jambes, cela est impossible et monstrueux. Ni que l'homme se monte au-dessus de soi et de l'humanité ». Ainsi, l'homme n'est pas Dieu et l'humanisme consiste à agir « humainement ».
Voir aussi néoplatonisme
Source : Wikipédia