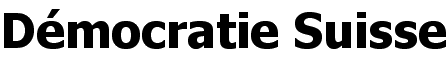Le cinéaste mauritanien Abderrahmane Sissako rompt le silence de la barbarie qui meurtrit le cœur de l’Afrique.
« N’être sensible qu’au malheur de celui qui nous ressemble physiquement et culturellement, c’est ça qui est terrible. »
Hervé Gourdel (55 ans), James Foley (45 ans), Peter Kassig (26 ans), Steven Sotloff (31 ans), David Haenes (40 ans), Alan Henning (47 ans)… Ils étaient travailleurs humanitaires, journalistes, guide de haute montagne. Tous Occidentaux, tous exécutés par des islamistes radicaux dans les six derniers mois, en représailles de la politique étrangère menée par leur pays respectif. Actes innommables. Barbarie absolue qui dure depuis des années maintenant.
Ces atrocités-là ne touchent pas uniquement les « étrangers ». Le cœur de l’Afrique saigne de la même barbarie mais cette réalité est nettement moins, voire pas du tout médiatisée. Ce qui fait hurler le cinéaste mauritanien Abderrahmane Sissako. Il a donc décidé de rompre le silence en racontant le drame vécu par une population malienne paisible tombée sous le joug des extrémistes religieux. Timbuktu se base sur un fait réel.
Pour beaucoup dont nous, votre film, en compétition officielle à Cannes, a été injustement oublié du Palmarès. Comment l’avez-vous vécu ?
Quand on est en compétition, l’espoir est naturel et d’autant plus légitime lorsqu’on a un sentiment d’unanimité autour d’un propos. Ça donne à croire davantage. Quand ça ne se passe pas, on est déçu et c’est très humain. Pour moi, c’est très passager. On ne fait pas un film pour un rendez-vous de palmarès. C’est plus triste quand c’est un continent (l’Afrique, NDLR) qui est déçu car il y a cru. Mais c’est bien de croire !
Vous avez décidé de faire « Timbuktu » suite à un fait divers atroce – la lapidation d’un couple dans un village au nord du Mali parce qu’ils n’étaient pas mariés devant Dieu – parce que ce drame innommable s’était déroulé dans l’indifférence des médias et du monde.
Quand on égorge aujourd’hui, il faut savoir qu’on a égorgé bien avant ! C’est pour dire ça que j’ai fait ce film. Quand des hommes mettent au milieu d’une place un homme et une femme qui n’ont fait que s’aimer, ont eu deux enfants et sont mis à mort de cette façon, c’est insupportable. Quand des hommes en armes encerclent une jeune fille et lui donnent 40 coups parce qu’elle a chanté et encore 40 coups car elle était dans une chambre avec son amoureux, c’est insupportable. Et cela se passe quotidiennement en Afrique !
On assiste à une autre médiatisation : celle des décapitations d’otages occidentaux diffusées sur internet. Que voulez-vous dire par rapport à ça ?
On est face à la stratégie de ceux qui égorgent et qui veulent le faire savoir en utilisant les moyens qui existent. Ils savent que ça marche. Rentrer dans la médiatisation de ces actes innommables envers des hommes ou des femmes qui sont souvent étrangers et appartiennent au monde des médias, est grave. Car si on y rentre, c’est parce qu’on a oublié que les autres mains, bras, cous coupés, ce sont des gens aussi. C’est ça qui est terrible pour moi, qu’il y ait des degrés de perception, de sensibilisation. N’être sensible qu’au malheur de celui qui nous ressemble physiquement et culturellement. Malheureusement, c’est ce qui se passe de manière générale.
À travers ces atrocités, l’islam est réduit à la barbarie. Or l’islam, c’est bien autre chose. Là est aussi votre message ?
Évidemment. C’est d’abord l’islam qui est pris en otage. Or on a joué de manière consciente ou par paresse intellectuelle sur l’amalgame. Je n’invente rien. Ma vision de l’islam qui est tolérance, amour de l’autre, acceptation de l’autre, est à 99,9 % la réalité de l’islam dans le monde. Donc quand, du jour au lendemain, des hommes armés prennent en otage les 100.000 hommes et femmes de Tombouctou qui vivaient selon leur foi, avec leur façon de s’habiller, de s’amuser, de vivre et qu’on n’en parle pas, c’est insupportable.
Est-ce vital pour vous de voir que les musulmans de France se positionnent publiquement contre ces actes terroristes ?
C’est très, très important. Et je ne dirais pas qu’ils l’ont fait tardivement, même si je le pense. Il faut se dresser contre chaque acte terroriste. Les musulmans ont trop tendance à penser que la foi, on la garde pour soi, et de se dire : « On n’est pas comme eux », mais ils n’ont pas envie de le dire aux autres. Or le voisin qui n’est pas musulman a besoin de l’entendre pour être rassuré. Les musulmans de France et de Belgique ont besoin aujourd’hui de dire : « J’ai pleuré moi aussi quand Hervé Gourdel a été égorgé. Je me sens mal en tant qu’être humain. Je suis contre ça. » Il faut qu’ils le disent. Il faut ce sursaut-là.
En utilisant l’art pour dénoncer, vous vous opposez aussi aux religieux radicaux. C’est votre façon de combattre ?
C’est une façon de prouver que rien, absolument rien ne peut vaincre la beauté, l’amour. On peut les dominer un moment, mais jamais les vaincre. Pour moi, c’est important de le rappeler à chaque moment. Mon film parle de la vie et de la mort, de la paternité, de la capacité d’un homme à accepter son sort. Quand on dit au personnage qu’il va mourir, il répond que ce n’est pas ça qui l’effraie, mais de ne plus voir sa fille. Cela veut dire que les extrémistes peuvent le tuer mais ne pourront jamais tuer la beauté de l’amour qu’il a pour sa fille. Dans l’obscurantisme, on peut interdire le football mais la résistance est dans l’imaginaire de ces gamins qui jouent avec un ballon invisible. Dans l’obscurantisme, on peut interdire de chanter mais la résistance, c’est chanter dans sa tête. Pour moi, c’est cette beauté-là qui va finalement triompher.
L’art peut-il changer le monde ?
Non ! Pas dans le sens d’un changement de masse. Mais un baiser peut changer quelqu’un. Un film aussi. Dans le sens où il peut permettre à cette personne de s’ouvrir davantage, de décider de connaître le nom de son voisin.
Mais comment encore entendre la voix de la raison et du Coran quand on est en zone rouge ?
En sortant de l’amalgame. En ouvrant vraiment les oreilles, les yeux et l’esprit. J’espère que cela se passera avec les spectateurs qui verront mon film. Je fais une proposition mais je n’implore pas.
De manière concrète, le tournage de votre film s’est-il déroulé sous haute surveillance ?
Oui, car c’était risqué, mais on avait la protection de l’Etat avec l’armée permanente, efficace, présente de manière visible et invisible. Pour exclure tout risque d’enlèvement car je travaillais avec une équipe étrangère. Mais le danger d’un attentat suicide existe toujours. Donc, on travaille avec cette angoisse-là. Mais il faut savoir prendre des risques, sinon c’est la victoire de l’autre. Si on se refuse de crier parce que c’est dangereux, c’est le triomphe de l’obscurantisme, du terrorisme.
Comment avez-vous travaillé avec vos acteurs, dont plusieurs étaient des amateurs ?
Dans un esprit de confiance. En leur donnant l’assurance qu’ils pouvaient jouer. J’essaie de mettre tout le monde au même niveau de fragilité que le mien. C’est de la fragilité que naît souvent la création.
Qu’est-ce qui vous révolte le plus dans le comportement des djihadistes ?
Tuer. Tuer des gens innocents, sans armes. Avec froideur et lâcheté. Peter Kassig était volontaire humanitaire, Hervé Gourdel un passionné de montagne. Qu’avaient-ils fait sinon d’être des passionnés des êtres ?
Vous parlez de froideur mais vous montrez des djihadistes dans une dimension humaine, voire grotesque…
Oui, je montre qu’ils peuvent servir un thé à l’otage et l’exécuter dans l’heure qui suit. Il y a une complexité dans chaque être humain, il y a le mal et le bien. Un djihadiste nous ressemble aussi, mais sa vie à lui a basculé. Celui qui maltraite peut douter. Pour moi, il y a en lui une humanité. Je montre aussi une autre violence, celle de la pauvreté, donc celle d’un monde qui ne partage pas et qui crée des inégalités, donc des souffrances.
Votre film a reçu le Bayard d’or du meilleur film au Festival international du film francophone à Namur. Que signifie pour vous cette notion de francophonie ?
La langue est un lien, c’est certain. Mais je n’aime pas quand on parle de « regard francophone » ou « réflexion francophone ». Je pense que les regards sont des regards, les sensibilités sont des sensibilités. Il y a des individualités qui appartiennent à des territoires et les dépassent car nous évoluons dans le monde. Donc la francophonie, pour moi, est une notion à laquelle il faut faire un peu attention. Pour moi, la francophonie n’existe que plurielle.
Que retenez-vous du tournage ?
Ma source de vie et de création se situe dans les rencontres. Mon expérience se fait avant, pendant et après le film. Tout, au final, devient une quête de soi-même. Le cinéma me permet, notamment dans l’écriture, de voir dans chaque personnage une force, un courage qu’on n’a pas. Un médecin soigne, un cinéaste partage sa vision.
Fabienne Bradfer pour Le Soir